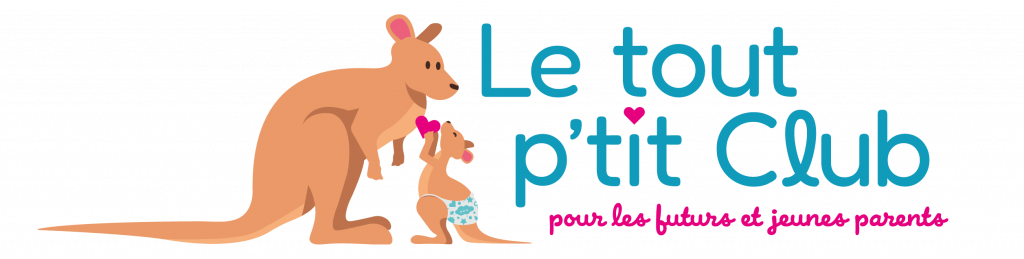Comprendre les différents types d’endométriose

L’endométriose est une maladie chronique qui se caractérise par la présence de tissu endométrial hors de la cavité utérine. Si elle touche environ une femme sur dix, elle demeure souvent sous-diagnostiquée… En partie à cause de sa grande variété de formes et de symptômes. Dans cet article, nous explorerons les différents types d’endométriose et leurs spécificités. Le diagnostic précis est important pour adapter la prise en charge.
Pourquoi plusieurs classifications ?
L’endométriose s’exprime de manière très hétérogène. Certaines personnes ressentent des douleurs intenses alors que leurs lésions sont de petite taille, tandis que d’autres peuvent présenter des kystes importants et souffrir peu. Les différentes localisations de l’endométriose (au niveau des ovaires, du péritoine, du rectum ou même du diaphragme) influencent également la symptomatologie. Cette complexité a conduit la communauté médicale à proposer plusieurs systèmes de classification, dont celui de l’American Society for Reproductive Medicine (ASRM), qui évalue l’endométriose selon quatre stades (I à IV) en fonction de l’étendue et de la profondeur des lésions.
1. L’endométriose superficielle ou péritonéale
La forme la plus fréquente, appelée « endométriose péritonéale superficielle », se caractérise par la présence de petits implants sur le péritoine, la membrane qui tapisse la cavité abdominale. Ces lésions peuvent être très discrètes et passer inaperçues lors d’une échographie standard. En général, elles peuvent provoquer des douleurs pendant les règles ou lors des rapports sexuels, sans forcément se manifester par des symptômes spectaculaires. Il n’est pas rare que cette forme demeure longtemps ignorée, tant elle peut être difficile à détecter.
2. L’endométriome ovarien (ou kyste endométriosique)
Lorsqu’un kyste se forme dans l’ovaire, on parle d’endométriome, parfois surnommé « kyste chocolat » en raison du liquide brunâtre qu’il contient. Les endométriomes sont souvent mis en évidence par une échographie pelvienne ou une IRM spécialisée. Ils peuvent provoquer des douleurs pelviennes, des troubles de la fertilité ou encore des inconforts lors des rapports sexuels. La taille du kyste varie d’une patiente à l’autre, et certains endométriomes nécessitent une intervention chirurgicale pour soulager la douleur ou préserver la fonction ovarienne.
3. L’endométriose profonde infiltrante
L’endométriose profonde infiltrante (EPI) se définit par des lésions qui pénètrent à plus de 5 mm sous la surface péritonéale. Elle est considérée comme plus sévère, notamment lorsqu’elle atteint le rectum, la vessie, les ligaments utéro-sacrés ou même certains nerfs pelviens. Les symptômes peuvent alors se manifester sous forme de douleurs très intenses pendant les règles, de difficultés lors de la défécation, de douleurs pelviennes constantes ou de crises douloureuses irradiant vers le bas du dos et les jambes.
Le diagnostic de l’endométriose profonde infiltrante requiert souvent une imagerie spécialisée. Telle que l’IRM pelvienne ou l’échographie endovaginale réalisée par un·e radiologue formé·e à l’endométriose. Parfois, seule la coelioscopie (chirurgie mini-invasive) permet de confirmer la présence et l’étendue de ce type de lésions.
4. L’endométriose extra-pelvienne
Bien que plus rare, l’endométriose peut s’implanter hors de la région pelvienne. On parle alors d’endométriose extra-pelvienne, qui peut toucher le système digestif (intestin grêle, côlon), le diaphragme, la paroi abdominale (par exemple sur une cicatrice post-césarienne), voire le thorax (poumons, plèvre). Lorsqu’elle atteint la zone thoracique, l’endométriose peut provoquer un pneumothorax cataménial (collapsus du poumon pendant les règles). Dans le cas de formes digestives, des douleurs à la défécation, des rectorragies ou des épisodes de constipation sévère peuvent survenir, surtout en période menstruelle.
Ces localisations atypiques compliquent encore le diagnostic, car les symptômes ne sont pas immédiatement associés à un trouble gynécologique. Une approche pluridisciplinaire impliquant gastro-entérologue, chirurgien digestif ou pneumologue peut alors s’avérer essentielle.
Et l’adénomyose dans tout ça ?
L’adénomyose est souvent décrite comme le « cousin » de l’endométriose. Dans cette pathologie, le tissu endométrial (celui qui tapisse normalement l’intérieur de l’utérus) pénètre dans le myomètre, c’est-à-dire la couche musculaire de l’utérus. On la qualifie parfois d’« endométriose interne », car le principe de base est similaire : du tissu endométrial se retrouve là où il ne devrait pas être. Cependant, la communauté médicale a tendance à considérer l’adénomyose comme une entité distincte, même si elle est étroitement apparentée à l’endométriose.
Les points communs incluent la douleur pelvienne, des règles abondantes et parfois des problèmes de fertilité. La différence majeure réside dans la localisation des lésions. Dans l’endométriose, on trouve du tissu endométrial en dehors de l’utérus (ovaires, péritoine, ligaments, etc.). Tandis que dans l’adénomyose, ce tissu est logé à l’intérieur de la paroi musculaire de l’utérus.
En pratique, une patiente peut présenter à la fois de l’endométriose et de l’adénomyose, mais le suivi et la prise en charge peuvent varier selon les cas. On retiendra donc que l’adénomyose n’est pas officiellement classée comme un type d’endométriose, même si les deux pathologies partagent des mécanismes et des symptômes similaires.
Découvrez le témoignage d’une patiente atteinte d’adénomyose, son parcours pour être diagnostiquée et ses conseils du quotidien.
Les formes combinées et la classification en stades
Il est fréquent qu’une même patiente présente à la fois de l’endométriose péritonéale superficielle, un endométriome ovarien et une atteinte profonde sur d’autres organes. L’intensité des douleurs ne reflète pas toujours la gravité anatomique des lésions, ce qui rend l’évaluation médicale d’autant plus délicate. La classification en stades (de I à IV selon l’ASRM) prend en compte la taille, le nombre et la profondeur des lésions, ainsi que la présence de kystes ou d’adhérences. Plus le stade est élevé, plus l’endométriose risque de causer des difficultés de fertilité et des douleurs importantes, sans que cela soit systématique.
Prise en charge et traitements
Le traitement de l’endométriose varie en fonction du type de lésions, de leur stade et des symptômes ressentis. Il peut inclure :
- Un traitement hormonal (pilule contraceptive ou progestatifs) pour freiner la progression de l’endométriose et réduire les douleurs.
- Une chirurgie (coelioscopie) visant à retirer ou détruire les implants endométriosiques, particulièrement en cas de formes profondes ou d’endométriomes volumineux.
- Des approches complémentaires, comme la kinésithérapie, la gestion du stress, l’adaptation alimentaire ou encore la pratique d’une activité physique régulière. À ce sujet, vous pouvez consulter notre article « Endométriose et sport, est-ce compatible ? »
Conclusion : vers une meilleure compréhension et une prise en charge adaptée
La connaissance des différents types d’endométriose est un facteur clé pour poser un diagnostic précis et proposer la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Qu’il s’agisse de formes superficielles, d’endométriomes ovariens ou de lésions infiltrantes… L’important est de ne pas minimiser les douleurs ou d’autres symptômes qui pourraient révéler la présence de la maladie. En parlant ouvertement de vos ressentis et en vous informant via des sources fiables, vous contribuez à briser les tabous entourant l’endométriose et à réduire le délai de diagnostic, encore trop long pour de nombreuses patientes.
Si vous souhaitez démêler le vrai du faux à propos de l’endométriose, nous vous invitons à lire notre article «Endométriose : entre vérités et idées reçues qui freinent le diagnostic ». Vous verrez les principales croyances erronées liées à cette maladie. Vous y trouverez des informations essentielles pour mieux comprendre ce trouble complexe et soutenir les personnes qui en sont atteintes.
(Cet article ne remplace pas un avis médical. En cas de symptôme persistant ou d’interrogation sur un diagnostic, consultez un·e professionnel·le de santé.)
Sources et références
Les informations présentées dans cet article sont basées sur des données issues de l’INSERM, de l’ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists. D’EndoFrance, ainsi que sur les recommandations du NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Des publications scientifiques telles que celles de l’American Society for Reproductive Medicine (ASRM). Et des revues spécialisées dans le domaine de la gynécologie et de la reproduction offrent un éclairage précieux sur la classification et la prise en charge de l’endométriose.